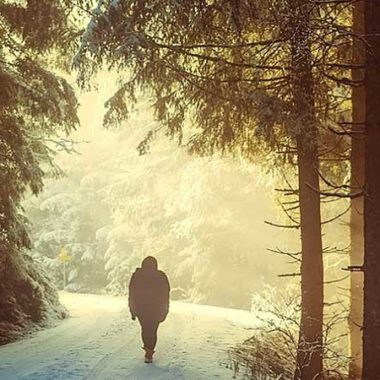Le prochain : un événement de relation
Luc 10, 25-37
« Et voici qu’un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l’épreuve : « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Dans la Loi qu’est-il écrit ? Comment lis-tu ? » Il lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits qui, l’ayant dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu’un prêtre descendait par ce chemin ; il vit l’homme et passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu ; il vit l’homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l’homme : il le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, banda ses plaies en y versant de l’huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant deux pièces d’argent, il les donna à l’aubergiste et lui dit : “ Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c’est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. ” Lequel des trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme qui était tombé sur les bandits ? » Le légiste répondit : « C’est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit : « Va et, toi aussi, fais de même. »
Lorsque nous nous interrogeons sur le sens de notre vocation, nous nous demandons toujours ce que nous devons faire. Et ce qui monte le plus souvent en nous devant la détresse dont nous sommes témoins – celle du monde, celle de ceux que nous côtoyons journellement -, c’est la culpabilité. Nous nous reconnaissons surtout dans le prêtre ou le lévite de notre parabole, dans ce mouvement d’évitement qui consiste « à passer à l’opposé », à changer de trottoir pour éviter la rencontre, et nous nous disons qu’il ne faudrait justement pas être comme eux. Nous nous sentons coupables de ne pas en faire plus, coupables de ne pas être un « bon Samaritain » (mais qui a dit qu’il était « bon » ?). Et nous nous flagellons intérieurement avec des impératifs moraux qui obéissent plus à notre surmoi qu’à l’Évangile !
Or, à lire ainsi notre parabole, nous nous faisons plus de mal que de bien et, surtout, nous ne sommes pas mis en route, nous ne produisons pas du neuf dans nos vies. Il y a peut-être une autre manière d’entendre la parole qui se cache dans cette parabole et qui offre de vivre du renversement qu’elle propose, à savoir qu’il ne s’agit pas d’avoir un prochain, comme un objet définissable d’avance, mais de se faire prochain pour l’autre.
Nous avons certainement à faire ici à une discussion rabbinique entre Jésus et un homme qui enseignait la Torah et son application dans la vie quotidienne. L’homme pose une question proprement théologique, la question du salut : « qu’ai-je à faire pour hériter de la vie éternelle ? » En posant cette question, le légiste veut certainement entendre ce que Jésus estime être le fondement à partir duquel interpréter toute la Loi de Moïse. Or Jésus lui renvoie la question : « Dans la loi, qu’est-il écrit ? Comment lis-tu ? » (v.26). Ce « comment » est fondamental. Dans l’Écriture en effet, il y a non seulement le texte, ce qui est écrit, mais il y a l’interprétation, la manière dont nous comprenons – au sens de prendre, d’emmener avec nous – ce que nous lisons. Et tout se joue là, car le texte reste lettre morte si nous ne lui apportons pas notre réponse. Pour que l’Écriture devienne une parole vive, pour que du neuf se lève dans nos vies, il faut faire ce qui est écrit, il faut le traduire, le faire résonner à travers toute notre manière d’être.
Et c’est bien ce que souligne Jésus en inscrivant précisément dans le faire l’enjeu de la relation à Dieu : « Fais cela et tu vivras » (v.28), « va et fais de même » (v.37), « fais » la miséricorde, ne dis pas que tu aimes, mais aime ; ne dis pas que tu crois en Dieu, mais crois !
Mais l’homme de la Loi n’est pas satisfait. Il cherche en réalité la faille par où il pourra piéger Jésus. Et la discussion qui suit est certainement le reflet des questions qui traversaient le judaïsme de l’époque. Différentes écoles rabbiniques s’affrontaient en effet sur la définition du prochain.
C’était tour à tour :
– l’Israélite, le compagnon d’une même communauté d’alliance
– celui qu’on doit aider matériellement, parce qu’il est dans le besoin
– le semblable
– l’humain, en tant qu’image de Dieu.
Or Jésus va renverser cette façon de voir en faisant comprendre au légiste que le prochain n’est pas une catégorie extérieure envers laquelle nous aurions des devoirs en général, mais qu’il est à chaque fois un événement de relation totalement imprévisible qui nous prend par surprise au détour du chemin ! Et pour dire cet événement, il faut bien une narration, il faut bien raconter une histoire.
Le personnage qui arrive en premier dans la parabole, c’est le blessé assailli par des voleurs et laissé à demi-mort au bord de la route. Il nous figure dans la fragilité constitutive de notre humanité. Comme lui, il nous arrive d’être par moment jetés à terre par la souffrance, physique ou psychique, par le chagrin, par une séparation, et comme lui, nous restons inanimés, abandonnés au bord de notre vie, sur la touche. Vivre, c’est ce risque perpétuel d’être exposé à la blessure d’événements et de relations qui nous volent à nous-mêmes en nous laissant dans un total dénuement. Nous sommes alors incapables de faire quoi que ce soit, ni pour nous-mêmes, ni pour autrui.
Mais il arrive, le hasard faisant bien les choses – mais est-ce le hasard ? -, qu’il y ait des passants… comme nous le rappelle notre parabole. Certains sont décidément très passants, ils passent outre, ils passent sans voir, comme le prêtre et le lévite ! Ce sont tous deux des religieux et leur attitude s’explique ici par un motif religieux. Le contact avec un mourant constituait en effet une source d’impureté et entraînait une mise à l’écart temporaire pour ceux qui, comme eux, exerçaient un service au Temple. Ces deux-là sont donc avant tout soucieux de préserver leur intégrité religieuse. Ils justifient leur indifférence à l’égard d’autrui par leur obéissance à la Loi. Ce n’est donc ni le rapport à Dieu ni le rapport au prochain qui les occupe mais le souci d’eux-mêmes.
Mais vous remarquerez l’absence de jugement de la parabole. C’est nous qui nous empressons de les blâmer alors que la parabole, elle, sait qu’en réalité ils nous figurent aussi. Ces deux-là, c’est nous quand nous allons et venons dans nos journées sans prêter attention à ceux qui sont sur le bord de la route. C’est nous quand nous sommes envahis par nos propres préoccupations, par notre besoin de nous justifier. Nous encore quand nous n’avons plus l’énergie d’entendre une souffrance qui nous laisse dans la culpabilité comme dans l’impuissance.
Mais il arrive aussi que quelqu’un ose une attitude différente, qu’il se rapproche là où les autres jouent l’indifférence, qu’il devienne un prochain pour nous qui sommes à terre et qu’il ouvre, par sa seule présence, une brèche dans l’impasse où nous sommes tombés. Le Samaritain « voit », mais à la différence des deux autres qui « passent à l’opposé », il est « touché aux entrailles » par le blessé. Or, très significativement, ce verbe n’est employé dans les Évangiles que pour Dieu et le Christ ! Ce détail doit nous arrêter car il rend manifeste que la compassion, celle qui peut nous saisir à la vue d’autrui souffrant, est d’abord une tendresse qui nous rencontre nous, les blessés de la vie. Il y a une très belle exégèse d’Irénée qui voit dans le Samaritain la figure du Christ prenant soin de notre humanité tombée aux mains du mal en la remettant à l’Esprit (l’aubergiste de notre parabole) pour qu’il nous réconforte et nous rende le souffle que nous avons perdu.
Ce qui caractérise le Samaritain (qui représentait le marginal, le déviant par rapport à l’orthodoxie juive de l’époque de Jésus), c’est son mouvement, qui est à la fois de compassion et de détachement. Il est ému par ce compagnon d’humanité gisant au bord de la route et dans lequel il se reconnaît. Saisissant l’urgence de la situation, il fait ce qui est nécessaire pour le sauver; puis, il s’en va, laissant à l’aubergiste le soin de prendre le relais. Il ne part toutefois pas, sans avoir veillé à régler la dette du séjour, de sorte que, une fois le blessé guéri, ce dernier soit vraiment libre d’aller de l’avant dans sa vie.
Oui, ce Samaritain est bien à l’image du Tout-Autre Samaritain qui veille sur nos vies et « qui par amour se penche et par amour s’en va » (Alain Lerbret) pour nous laisser libres d’aller à notre tour et faire de même ! C’est-à-dire libres d’entrer dans cette légèreté de l’amour où nous nous rendons proches de quelqu’un pour un temps et où nous le laissons aller ensuite dans sa vie, sans l’attacher à nous.
Nous ne sommes pas à chaque instant des prochains pour tout le monde. Nous ne pouvons pas soulager la souffrance de l’humanité entière. C’est impossible et cela ne nous est pas demandé. Ce qui par contre nous est demandé, c’est de ne pas manquer ceux et celles qui se trouvent sur notre route, momentanément immobilisés aux marges de la vie, en nous souvenant que nous aussi un jour nous étions mourants et que nous avons respiré un peu mieux parce que quelqu’un s’est penché sur nous pour verser de l’huile sur nos blessures.
Ce que la parabole nous enseigne, donc, c’est que le prochain n’est pas une catégorie générale, mais un événement de relation, un avènement d’amour qui surgit à l’improviste sur notre chemin et qui requiert notre réponse, notre responsabilité pour un moment. Il n’y a pas de définition préalable du prochain, car, comme le souligne Bernard Rordorf, « pouvoir définir son prochain, ce serait se condamner à ne jamais le rencontrer » (Va et fais de même, in Liberté de parole, Esquisses théologiques, Labor et Fides, 2005, p.171). On devient soi-même un prochain parce qu’on se laisse affecter par autrui, parce qu’on s’approche de lui, non par devoir moral, mais parce qu’on est ému aux entrailles. On devient un prochain chaque fois qu’on ne peut éluder la question qui nous arrive à travers le visage d’un autre et qui est à chaque fois la mise en question de notre petit moi. Et la réponse n’est jamais donnée d’avance, elle doit toujours à nouveau être inventée.
À l’interrogation première du légiste : que dois-je faire pour être dans la vie qu’on appelle vie éternelle – et qui n’est pas que pour après ou ailleurs, mais qui commence ici et maintenant-, il ne saurait donc y avoir de réponse toute faite. L’obéissance au commandement d’amour de Dieu et du prochain ne se vit pas à travers un catalogue d’actions répertoriées d’avance, mais elle a essentiellement lieu dans cette ouverture du cœur dont témoigne le Samaritain, une ouverture que nous ne saurions maîtriser, car elle est avant tout l’œuvre en nous d’un Autre que nous-mêmes.
Aller et faire de même, c’est donc se dessaisir de toute prétention à maîtriser sa vie pour accueillir le Christ qui s’approche et libère du souci de justifier par nous-mêmes notre existence. Si nous lisons l’Évangile comme un recueil d’exemples à imiter, cela ne fait pas encore de nous des disciples du Christ, car non seulement cela ne change pas notre cœur en profondeur, mais cela nous prive du don qui nous arrive à travers lui. Comme le dit Luther, « l’article principal et le fondement de l’Évangile, c’est que, avant de prendre le Christ pour exemple, tu le reçoives et le reconnaisses comme un don et comme un cadeau qui t’a été octroyé par Dieu et qui t’appartient. » Il n’y a que la conscience de ce don qui puisse transformer en profondeur. Tout le reste n’est que discours, illusion, bonnes intentions.
Aller et faire de même, c’est donc entendre la vocation que nous avons reçue du Christ lui-même et qui ne consiste pas à vouloir maîtriser utopiquement le cours du monde et de nos vies, mais bien à entrer au service de l’avenir que Dieu prépare et qui s’annonce à travers les multiples appels qui sont à entendre dans le visage d’autrui et qui requièrent de notre part non pas une sourde culpabilité, mais une réponse à chaque fois singulière autant qu’inventive.
Extrait « Une parole au vif de l’humain »