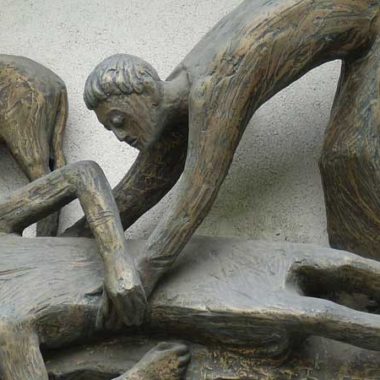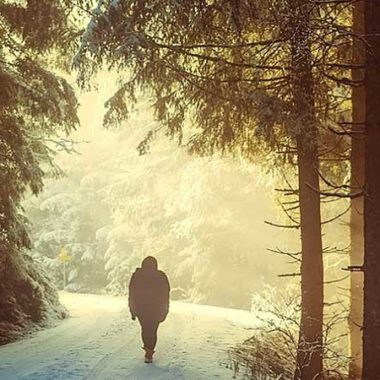La joie : un trésor des profondeurs
Matthieu 13, 44-46
« Le Royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu’un homme a découvert : il le cache à nouveau et, dans sa joie, il s’en va, met en vente tout ce qu’il a et il achète ce champ. Le Royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s’en est allé vendre tout ce qu’il avait et il l’a achetée. »
Jésus a vraisemblablement beaucoup parlé en paraboles. Si l’on enlève les deux lettres centrales de « parabole », a et b, on trouve « parole ». Dans toute parabole se tient une parole à déchiffrer, un message à décoder. C’est pour cela que les paraboles attirent et attisent la curiosité : parce qu’on y pressent une énigme à résoudre, du sens à faire émerger.
On pourrait appliquer aux paraboles ce que Paul Klee disait de l’art : « L’art ne reproduit pas le visible, mais rend visible » (dans Confession créatrice et Poèmes). Ainsi font les paraboles. À partir d’images simples, puisées dans le quotidien, elles font voir cette vibration de la vie sur laquelle nous ne pouvons jamais mettre la main, mais qui nous anime du dedans. Elles disent l’indicible, elles font entendre l’inouï. Bref, elles nous mettent en mouvement en nous tenant en haleine… et c’est pourquoi elles sont inépuisables. Nous n’avons jamais fini de les déchiffrer parce que le mystère qu’elles racontent est lui-même infini.
Les paraboles de Jésus sont avant tout des paraboles du royaume de Dieu. On se souviendra que, depuis toujours, aux yeux d’Israël, la royauté appartient à Dieu seul, les rois de la terre n’étant que ses lieutenants, ses représentants. Au temps de Jésus, il n’y a plus en Palestine de roi ni de royaume tels qu’Israël les a connus au début de son existence politique. Mais de ce passé les Juifs ont hérité un souvenir nostalgique et une catégorie de pensée. Ils attendent que YHWH vienne établir définitivement son règne sur l’univers entier, et plus particulièrement sur Israël et les nations.
À l’époque de Jésus, nombreux étaient ceux qui revendiquaient pour Israël la délivrance de l’oppression romaine. Certains, comme les zélotes, n’hésitaient pas à prendre les armes ; d’autres, comme les pharisiens, comptaient sur l’obéissance à la Loi pour garantir l’événement ; d’autres encore, comme à Qûmran, se retiraient pour créer un royaume de pureté et de perfection.
Et voilà que, au milieu de tous ces courants politiques et théologiques, Jésus fait entendre une parole autre sur le royaume de Dieu, une parole qui opère un décrochement par rapport aux images et aux attentes de ses contemporains. Et il le fait en utilisant précisément les paraboles qui sont une forme d’enseignement bien connue dans la tradition rabbinique.
Pourquoi les paraboles ? Parce qu’elles permettent précisément de sortir d’une conception linéaire du temps où l’on attend pour demain ce que l’on ne peut pas vivre aujourd’hui. Jésus déplace ainsi la tension – l’attention ! – entre le présent et l’avenir, vers une autre profondeur, celle qu’il y a entre le caché et le révélé. Ce thème du caché/ révélé court d’ailleurs à travers tout Matthieu 13 et sert d’explication au parler de Jésus en paraboles : « J’ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde » (Mt13,35).
Ce qu’il faut chercher, c’est la vie qui est cachée sous l’aujourd’hui, car c’est cela qui a du prix. La question n’est donc plus d’attendre ni même d’espérer ce qui est à venir. Elle est de s’éveiller à ce qui est en train de naître, là, sous l’instant présent.
Que Jésus inaugure son ministère à Nazareth en déclarant que « le royaume de Dieu s’est approché : convertissez- vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1,15) est significatif de ce déplacement. Cette déclaration a dû pour le moins choquer ceux qui l’ont entendue. Ils ont surtout dû la trouver pauvre de conséquence, car elle ne s’est accompagnée d’aucune manifestation apocalyptique fracassante ! Ce ne sont pas les quelques paroles de ce fils de charpentier qui ont hâté la fin du monde et apporté la libération définitive d’Israël.
Alors, si ce n’est pas ça, qu’est-ce que ça peut bien être ? Les histoires qu’il raconte sont beaucoup plus que des histoires précisément ! Car elles ne laissent pas indemnes ceux à qui elles s’adressent. Elles les piquent, elles les interrogent, elles font bouger quelque chose à l’intérieur d’eux-mêmes. Et ce mouvement-là est justement le signe du royaume que Jésus annonce.
Il est question d’un trésor et d’un marchand de perles ; mais le royaume n’est pas le trésor, il n’est pas non plus le marchand. Le royaume, ce n’est pas un homme ou une chose, c’est ce qui arrive quand un homme trouve un trésor ou une perle. Le royaume, c’est un événement qui arrive à quelqu’un. C’est un déplacement, c’est l’ouverture à du neuf, c’est une histoire ouverte dont le langage ne peut rendre compte… qu’en la racontant !
Qu’il y ait une ouverture, qu’il y ait un possible, qu’il y ait un demain, c’est cela que nous avons besoin d’entendre dans nos enfermements, dans tous ces lieux de nos vies où nous vivons des impasses, dans notre relation à nous-mêmes et aux autres où nous sommes dans le découragement ou dans le ressentiment. Le royaume, c’est finalement qu’il y ait encore de l’amour possible, qu’il y ait encore quelque chose de plein à vivre. Et cela ne peut que nous être donné. L’homme qui travaillait aux champs – certainement un journalier engagé par un paysan – ne cherchait rien. Il tombe sur un trésor (le marchand lui, cherchait, mais il est aussi tombé sur la perle rare par hasard). Le trésor, c’est évidemment un mot qui fait rêver. Les trésors, et surtout les trésors cachés, font partie des contes et légendes de tous les pays du monde.
Il faut savoir que dans la Palestine du temps de Jésus, il n’y avait ni banque ni coffres-forts. La meilleure manière de tromper les voleurs était donc de cacher sa fortune dans une cassette et de l’enfouir quelque part dans la terre. Il arrivait que le propriétaire ne retrouve plus son bien et d’autres personnes pouvaient alors tomber dessus par hasard. C’est bien ce qui arrive ici à cet ouvrier agricole qui bute sur un objet qu’il n’a pas cherché mais qui va changer sa vie.
Celui qui entend l’histoire se réjouit et il a hâte de connaître la suite. Il s’identifie à l’homme chanceux : me voici devant une cassette ou une cruche d’argile pleine de pièces d’or qui n’appartiennent à personne, qui n’attendent que moi pour les prendre. Que vais-je faire ?
On pourrait imaginer différentes suites à cette l’histoire. La plus naturelle aurait été que l’homme emporte tout de suite le trésor sans rien dire à personne et qu’il s’offre enfin ce dont il rêvait depuis longtemps. On trouve d’ailleurs une version qui va dans ce sens dans l’évangile apocryphe de Thomas où le royaume est comparé à un homme qui a dans son champ un trésor qu’il ne connait pas. Il vient à mourir et le fils qui n’en sait rien non plus vend le champ. L’acheteur retourne le champ et y découvre le trésor. Il se met alors à prêter de l’argent à usure. On ne sait pas la suite, mais on suppose qu’il fait fortune.
Ici, rien de tel. L’intérêt n’est pas de savoir ce que l’homme fait du trésor, mais ce que le trésor fait de lui, ce que le trésor fait en lui. Et le récit nous conduit tout à fait ailleurs que là où nous emmène notre imagination. Si nous lisons bien, il nous fait buter – comme l’ouvrier sur sa cassette ! -, sur un petit groupe de mots insolites, parce que pas vraiment indispensables à la narration : « dans sa joie ». Et c’est ici qu’intervient l’effet de surprise qui est le propre des paraboles racontées par Jésus. Ce qui est incontournable, c’est cette joie qui arrive tout à coup et c’est surtout ce qu’elle produit dans l’homme.
Celui-ci agit sans précipitation. Il cache à nouveau le trésor et s’en va. Quelle liberté dans cette manière d’aller et de laisser là ce qu’il vient de découvrir et qu’il pressent porteur d’un sens qu’il n’avait pas rencontré jusque-là ! Tout le contraire de l’avidité et de la peur de perdre ce qu’il a trouvé. Il a confiance, il se donne du temps, il va et surtout il vend tout ce qu’il a pour acheter ce champ. Selon le droit de l’époque, les trésors que l’acheteur d’un terrain trouvait en faisant des fouilles lui appartenaient. L’homme fait donc ce qu’il faut pour être en règle et pour éviter toute contestation possible. Désormais, ce qui est au cœur de son désir, c’est ce trésor découvert au hasard d’un coup de houe. De tout le reste, il peut se détacher, car c’est sans importance. Ainsi en est-il de la vie et de la présence de Dieu. Une fois que nous y avons goûté, ce qu’elles provoquent en nous, c’est une nouvelle liberté à l’égard de tout ce qui nous attache, de tout ce à quoi nous sommes mal noués : certains liens affectifs comme certaines relations aux choses ou à l’argent. Cette liberté arrive à cause de la joie d’avoir trouvé ce qui nous tient réellement en vie. Et c’est cette joie-là, imprévue et inestimable, qui vient réveiller en nous le désir de l’essentiel, le désir d’alléger nos vies plutôt que de les alourdir en capitalisant. Le dépouillement dont parle notre parabole n’est pas un moyen d’accéder au royaume, mais bien la conséquence de sa découverte. On n’achète pas le royaume, mais quand on le trouve, on met le prix pour le garder.
L’histoire ne dit pas ce qu’il est advenu de l’homme au trésor ni du marchand. Les paraboles de la Bible restent souvent inachevées, comme un signe pour nous laisser entendre que le royaume continue de s’approcher, chaque jour, à chaque instant. L’extraordinaire n’est pas ailleurs, il est dans la profondeur de l’ordinaire. À nous d’exercer notre regard. Et les choses cachées depuis la fondation du monde nous seront alors révélées.
Extrait « Une parole au vif de l’humain »